Elise ou
la vraie vie
Claire Etcherelli
Editions Denoël, 1967 - Collection Folio
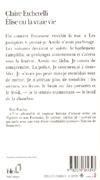
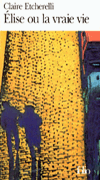
1 - Introduction
2 - Le titre
3 - L'histoire
4 - La toile de fond
5 - Conclusion
Claire Etcherelli est un auteur fortement engagé dans la lutte pour la défense de l'Algérie. Encore, à ce jour, on retrouve son nom dans des prises de positions au profit de l'Algérie. Ainsi, elle fait partie du comité de parrainage de la revue périodique Algérie, littérature, action.
LE TITRE
: Elise ou la vraie vie
De part la conjonction de coordination " ou ", il semble y avoir une
dichotomie entre " Elise " et " la vraie vie ". En effet, cette césure paraît
mettre en opposition les deux entités, comme si les deux ne pouvaient pas
aller ensemble, se " côtoyer ".
C'est comme si " Elise ", entité provinciale,
était incompatible avec " l'autre Elise ", la parisienne, qui mène " la vraie
vie ". Il existe là un décalage. De part la force que dégage l'expression
" la vraie vie ", on sent comme un étouffement de " Elise ". " La vraie vie
" n'est-elle pas alors dominatrice d'Elise, la provinciale ? Ne pourrait-on
pas ici rajouter le terme de " vie parisienne ", ceci en référence à l'image
superficielle qu'elle a pu générer à un certain moment ?
Ceci se retrouve dans l'histoire puisque, en effet, Elise quitte sa vie de provinciale " insignifiante " pour vivre, au départ provisoirement, puis définitivement pense-t-elle, à Paris.
De plus, ce " ou " indique qu'Elise ne peut pas entretenir une dialectique avec " vraie vie ". En fait, il n'apparaît pas possible de lier les deux entités, les deux " concepts " par la conjonction de coordination " et " puisque les deux sont antinomiques et entretiennent une relation duale.
L'idée de " vraie vie " revient constamment au cours de l'histoire. Selon Elise, la " vraie vie " est synonyme d'indépendance, de spectacles, de culture et principalement, d'existence dans une société dans laquelle elle se sent insignifiante.
L'HISTOIRE :
Elle se passe dans
la France du XXème siècle, plus précisément entre 1954 et 1959, pendant la
guerre d'Algérie. C'est l'histoire d'une famille bordelaise constituée de
trois membres : Elise, son frère cadet Lucien, auquel elle voue une véritable
admiration et leur grand-mère. Ils vivent dans un petit appartement sordide
et étroit.
Elise, très retirée du reste du monde, ne vit qu'au travers de son frère et
rêve constamment à la " vraie vie ". Toutes ses connaissances proviennent
de Lucien qui, bien qu'il n'y prête plus attention, lui permet inconsciemment
d'exister et d'être reliée au monde extérieur.
Lucien ne travaille pas, il " étudie " et passe la majeure partie de son temps
auprès de Marie-Louise, son amour neuf avec lequel il se mariera et emménagera
dans l'appartement déjà trop petit pour trois. Quelques temps après, un enfant
naîtra de cette union.
Elise et la grand-mère n'ont que fort peu de contact avec l'extérieur. Par la rencontre d'Henri, un ami d'enfance, Lucien va introduire des préoccupations nouvelles dans ce monde clos. Henri va faire vibrer chez Lucien des sentiments contradictoires et violents. Il est pour Lucien un grand frère digne de confiance qu'il admire et auquel il veut plaire. Henri éveillera alors, chez le frère et la sœur, une conscience politique ou tout au moins l'intérêt pour l'actualité. D'autre part, Lucien sera toujours sans le sou, mensonge ou vérité…, toujours est-il qu'Elise donnera sans cesse de l'argent à ce frère tant adulé.
Un jour Elise trouve
une lettre adressée à Lucien. Elle a été écrite par une certaine Anna, une
amie à lui. Ladite lettre marque la fin d'une ère et dès lors tout change.
La rencontre avec Anna se présente comme une nouvelle quête de l'amour. Elle
offre à Lucien une image féminine neuve et plus contestatrice à l'inverse
de Marie-Louise, femme soumise. Liée à la vie sociale et politique, Anna apporte
une nouvelle vision du monde.
Le mariage avec Marie-Louise se révèle un échec. De fait, Lucien n'hésite
pas à la quitter pour partir à Paris. Quelque temps après Anna sera amenée
à le rejoindre.
Elise supporte mal le départ de Lucien, son frère, son lien unique avec le monde. A l'occasion d'un séjour en maison de repos de la grand-mère, Elise décide de partir rejoindre son frère à Paris. Sans argent, pour ce faire, elle met en gage les bijoux de la grand-mère sans l'en avertir.
A Paris, Elise regrette sa vie claustrée. Le manque d'argent se faisant ressentir, son frère lui propose alors de travailler dans l'usine qui l'emploie - un travail de contrôle. Elle accepte tout en sachant qu'elle repartira bientôt ; mais avant elle doit gagner suffisamment d'argent pour récupérer les bijoux de la grand-mère. Elle vie toujours dans l'ombre de Lucien mais grâce à son travail, petit à petit, elle se détache de lui. Pourtant les sentiments d'amour et d'affection qu'elle éprouve pour son frère perdureront au long de l'histoire. L'acceptation de cet emploi va marquer un tournant dans la vie d'Elise : elle ne le sait pas encore mais grâce à cet emploi, elle va goûter à ce qu'elle pensait être la " vraie vie ".
Nouvelle arrivante à l'usine, Elise a des difficultés à s'intégrer et à effectuer la tâche qui lui est assignée et qui consiste à contrôler les voitures qui, au début, défilent selon elle à une cadence effrayante. Elise s'habitue progressivement à cette vie, aux trajets quotidiens, aux repas et également aux sifflements des ouvriers alors qu'elle traverse l'atelier et qui, avec le temps, s'affaibliront pour laisser place plus tard aux regards réprobateurs.
A l'usine, Elise rencontre
Arezki, un homme qui va bouleverser sa vie et faire naître en elle des sensations
inconnues qu'elle avait seulement imaginées par l'intermédiaire de la vie
amoureuse de son frère et de Marie-Louise qui sera remplacée ultérieurement
par Anna. L'intérêt porté à Arezki naît lentement. Il y a les premiers rendez-vous
donnés sous couvert de la chaîne et au travers des cadences infernales. Progressivement
la présence de l'autre deviendra indispensable.
Cette belle histoire d'amour, synonyme de la " vraie vie " pour Elise, se
laissera obscurcir rapidement par des obstacles raciaux et politiques. Il
n'est pas souhaitable en ce début de l'année 1958 d'être un algérien à Paris
et pour une française de fréquenter un algérien. C'est la guerre et l'Algérien
est considéré, à cette époque comme l'ennemi, aussi règne-t-il une atmosphère
d'angoisse, de peur et de haine réciproque. C'est pourquoi Elise et Arezki
ne se voient qu'en cachette et leur liaison restera secrète jusqu'à ce que
Lucien la révèle. Les principales menaces pour les arabes sont les rafles
et les perquisitions. La nuit est dangereuse, que ce soit dans la rue, au
sortir du métro ou chez soi. La police embarque l'immigré. La police est omniprésente
et donnera à cette histoire d'amour une fin tragique. Elise, de par son amour
pour Arezki fait abstraction de tout cela.
Quand elle perd ceux qu'elle a le plus aimé, Elise découvre alors l'autre " vraie vie ", celle qu'elle n'envisageait pas. Elle réalise que la " vraie vie " imaginée dans sa province natale se trouve déjà derrière elle et qu'elle a eu fort peu de temps pour la vivre.
LA TOILE DE FOND :
Nous sommes en pleine
guerre d'Algérie. Les conditions d'existence sont dramatiques pour les algériens
de métropole. Ainsi, l'histoire s'inscrit dans un climat politique et social
influencé par le conflit en cours. Les arrestations massives, les mouvements
sociaux et politiques, la violence et les mesures répressives sont omniprésentes.
L'intervention de la police au domicile d'Arezki et l'obligation qui lui est
faite de se mettre nu devant Elise est très significative du climat qui sévit
à cette époque à Paris et aussi dans toutes la France. Il en est de même en
ce qui concerne le monde du travail au travers de la réplique du " gardien
à casquette " qui demande à un étranger : " qu'est-ce que tu veux ? " et qu'il
lui répond qu'il n'y a pas d'embauche alors que quelques lignes (ou quelques
temps) après, il s'adresse à Elise de la façon suivant : " c'est pour l'embauche
?[…] Allez-y " (page 74).
Ici deux éléments apparaissent. Le premièr concerne l'attitude du gardien
qui tutoie l'homme alors qu'Elise est vouvoyée, tandis que le second exclut
toute possibilité d'embauche pour l'homme alors que pour Elise, l'embauche
est possible. C'est une attitude à deux temps qu'adopte le gardien, laquelle
attitude se retrouve plus loin, dans le cabine du docteur qui dit : " Tu t'appelles
comment ? Répète ? C'est bien compliqué à dire ? Tu t'appelles Mohammed ?
Et il se mit à rire. Tous les Arabes s'appellent Mohammed. […puis vient le
tour d'Elise à laquelle il s'adresse différemment] Pourquoi n'avez-vous pas
demandé un emploi dans les bureaux ? Vous savez où vous allez ? Vous allez
à la chaîne, avec tout un tas d'étranger, beaucoup d'Algériens. Vous ne pourrez
pas y rester… " De par ces propos d'exclusion, le lecteur s'aperçoit de l'effet
qu'engendre la guerre d'Algérie et les craintes qu'elle fomente dans les mentalités
autochtones. Ces attitudes, tout comme celles observées par les forces de
police dans leurs rafles, ont pour conséquence la fermeture de l'accès à l'emploi
et plus généralement au monde du travail pour les populations immigrées d'Afrique
de Nord et plus particulièrement algériennes.
Au delà de ce tableau
de conflit social, il y a l'usine. Cette usine qui, contrairement aux " français
" membres de la hiérarchie, avale les hommes et les femmes, sans distinction
de race et de religion, dès le matin, qui prend le temps de les digérer pour
les recracher le soir, épuisés par le travail [on retrouve là, l'impression
donnée par l'ogre que représente la mine dans Germinal de E. Zola]. Chacun
y est anonyme : " les hommes et les femmes qui passaient devant moi ne me
remarquèrent pas " (page 73). Les trajets font parties intégrantes de l'usine,
de la journée de travail.
Les journées sont rythmées par les cadences infernales et " la vie de l'ouvrier,
elle commence à l'instant où finit le travail. Comme il faut bien dormir un
peu, ça ne fait pas beaucoup d'heures à vivre " (page 84).
Omniprésente dès la
deuxième partie de l'œuvre, l'usine apparaît avec " un immense mur et d'immenses
portes de fer " (page 73), rien ne laisse paraître ce qu'il y a derrière ;
ou plutôt cela permet de supposer, de chercher à imaginer ce que ces grands
murs dissimulent. L'image extérieure laisse place à une imagination grise,
sans âme.
Au travers de cette description, Claire Etcherelli fait pénétrer le lecteur
dans l'usine en même temps que les travailleurs ; il y a comme un effet de
zoom quasi cinématographique qui progresse de l'extérieur vers l'intérieur
pour arriver progressivement après des passages successifs dans les différents
bureaux et ateliers, au moment de la chaîne où est employée Elise.
C'est l'usine avec
toutes les implications qu'elle engendre. L'ère du taylorisme est encore de
rigueur avec le travail à la chaîne, " c'est la chaîne " avec ses cadences,
ses bruits, cette nécessité de toujours faire mieux pour avoir le boni.
L'Organisation Scientifique du Travail de Taylor masque l'identité de chacun,
les discussions sont synonymes de temps perdu, de perte de vitesse et par
conséquent de " coulage " et donc de chaîne à remonter. Il ne faut en aucun
cas s'interrompre sinon il faut vite se faire remplacer ; si l'on doit s'absenter
quelques minutes, il faut se faire signer un bon de sortie. Tout est minuté,
chronométré.
L'auteur décrit l'usine de telle façon que le lecteur peut en sentir les odeurs, la chaleur, il peut aussi la visualiser. Il n'a pas besoin de la connaître pour se l'imaginer. " La porte de l'atelier franchie, ça y est : odeurs et bruits vous prenaient entre leurs pinces et vous pouviez toujours lutter, ils vous terrassaient à la fin. Les bruits surtout ; les moteurs, les marteaux, les machines outils stridentes comme des scies, et, à intervalles réguliers, la chute des ferrailles " - (page 152).
Cette description saisi le lecteur : " la vraie vie, mon frère, je te retiens ! […] Mortel réveil, porte de Choisy. Une odeur d'usine avant même d'y pénétrer. Trois minutes de vestiaire et des heures de chaînes. La chaîne, ô le mot juste… Attachés à nos places. Sans comprendre sans voir. Et dépendant les uns des autres […] entre la graisse et le cambouis, la peinture au goudron et la sueur fétide… " - (page 99).
Ici, la guerre d'Algérie
fait obstacle à l'intégration sociale, thème développé par Durkheim. Cet aspect
de la théorie durkheimienne est repris par la définition de l'intégration
sociale selon trois caractéristiques telle qu'elle est donnée par Philippe
Besnard : " Un groupe social sera dit intégré dans la mesure où ses membres
: 1) possèdent une conscience commune, partagent les mêmes sentiments, croyances
et pratiques (société religieuse) ; 2) sont en interaction les uns avec les
autres (société domestique) ; 3) se sentent voués à des buts communs (société
politique) " P. Besnard - La sociologie de Durkheim.
Ainsi, le travail sur la chaîne, la division du travail, au lieu d'engendrer
un lien social se traduisant par l'intégration sociale, la conscience collective
et la contrainte sociale donc la solidarité, entraîne, du fait de la guerre
d'Algérie un cloisonnement entre les français de métropole et les algériens.
On retrouve donc cette idée de solidarité développée par Durkeim dans chacun
des deux " collectifs ouvriers" présent dans l'usine. A ces deux collectifs,
on peut en rajouter un troisième, celui des français de métropole qui se mobilisent,
comme le font Elise et son frère, en faveur des algériens. Ceux-ci sont exclus
par le collectif " français " et ceci est vérifié par les propos tenus par
le chef d'équipe quand Elise lui demande de changer son frère de place car
les odeurs de peinture sont nocives pour sa santé et qu'il en est affaibli.
En effet il lui répond qu'il ne peut rien faire étant donné les ennuis qu'il
a déjà causé, le poste qu'il occupe apparaît là, en quelque sorte, comme une
" punition ", un blâme.
On retrouve cette idée lors de l'interruption de la chaîne suite à un incident.
La réparation devant être longue, l'ensemble des populations algériennes et
tunisiennes de l'usine se met à claquer des mains, " scandant les mots que
Mustapha du haut de sa voiture lançait dans le soleil. Il y avait […] un cercle
d'hommes qui tapaient en chantant, les yeux presque blancs, roulant la tête.
Ce n'était plus un jeu, c'était, au sens pur du mot, une détente, une revanche
sur les gestes rétrécis de la chaîne, sur son rythme étriqué. Les français
mettaient un point d'honneur à ne pas s'approcher. […] Des sauvages et leur
musique de sauvages[…] Les hommes aux couteaux dans la poche, les fainéants,
voleurs, menteurs, sauvages, cruels, sales, des norafs. " - (page 235/236).
Ici, on voit bien la façon dont le collectif français de métropole traite,
considère les " français musulmans " (page 236), avec mépris. Ce mépris rejaillit
sur les attitudes à l'égard d'Elise, Lucien et les autres sympathisants.
Apparaît aussi dans cette citation, à propos de la chaîne, les termes de " gestes rétrécis " et de " rythme étriqué ". On voit ici comment la chaîne est perçue et vécue. Il existe comme un besoin de défoulement, de " revanche " pour reprendre le terme de l'auteur. Le fait de bouger, de se mouvoir, " de taper des mains ", donne un sentiment de liberté à l'ouvrier qui dans l'ampleur de son mouvement déploie, au-delà de ses membres, sa faculté de s'auto-libérer des gestes de la chaîne qui non seulement l'aliènent mentalement mais aussi le sclérosent physiquement.
L'usine, omniprésente dans le livre agit et influe, tel un personnage, sur les individus et dans leurs rapports au monde. Elle rythme leur vie, saccade leurs loisirs et enivre leurs existences. Ainsi, les propos tenus par l'oncle d'Arezki sont significatifs de l'influence du milieu de travail sur l'homme en tant qu'individu : " …je leur ai dit , tant pis, frappez moi, tuez-moi, je peux pas m'en passer. Trente ans que je travaille en France. Vingt ans de fonderie. Dix ans que je fais le veilleur de nuit. Il faut que je boive.[…] mais à mon âge, les habitudes ne me quittent pas. Je paierai " - (page 203). Dans ses paroles, on sent bien que l'homme est prêt, après avoir payé de sa santé, à payer encore, non seulement de son maigre portefeuille, mais aussi de sa vie au travers de la boisson et des conséquences qu'elle peut engendrer.
En fait, dans la majeure partie de l'ouvrage on voit alternativement l'usine comme élément dompteur des individus et, à l'extérieur, l'impact de la police et l'empreinte laissée par le travail sur les hommes. L'impression est telle que le lecteur lui aussi se laisse envahir par la grisaille de l'usine, la tourmente de l'extérieur, de Paris et l'obscurité des chambres qui tiennent lieu de domicile à Elise, Lucien, Anna, la grand-mère, Arezki et les autres.
En ce qui concerne Elise, elle a le sentiment d'exister alors qu'à Bordeaux, comme énoncé précédemment, elle est Elise, tout simplement. L'autre Elise, celle qui n'existe qu'au travers son frère.
Tout comme l'histoire
d'amour vécue et décrite avec pudeur, l'usine fait vibrer le lecteur au rythme
des cadences infernales de la chaîne. En fait, il serait plus juste de dire
que c'est l'usine qui rythme l'histoire d'amour d'Elise et Arezki. Ainsi on
voit combien les instants de liberté que laisse l'usine sont empreints des
vestiaires, des ateliers, des sifflements, des regards, des rumeurs, de la
chaîne et des rencontres fortuites dans les voitures à équiper et à contrôler.
On peut rapprocher ces différents moments à l'intérieur de l'usine avec ceux
de l'histoire vécues par les deux personnages à l'extérieur, selon le parallèle
suivant :
- vestiaires
: le moment auquel il doivent se quitter après une rencontre
- ateliers : la rue
- sifflements : la police
- regards : ceux des gens désapprouvent leur liaison (dans les
bars par exemple)
- rumeurs : les positions négatives prises par les algériens
quand Elise assiste à leur réunion secrète
- la chaîne : la nécessité de se cacher en permanence, les moments
volés
- les rencontres : les moments rares et privilégiés qu'ils peuvent
passer ensemble sans avoir rencontrés l'ensemble des points précédemment énoncés.
On voit bien que la vraie vie imaginée initialement ailleurs par Elise n'est pas significative de la réalité. Les contrastes et rapprochements observés entre les deux mondes clos et ouverts ne sont pas interdépendants d'un style ou d'un lieu de vie. Ainsi Elise aurait très bien pu connaître, telle qu'elle l'imaginait, la vraie vie dans sa province de Bordeaux .
Au-delà du plaidoyer
en faveur de la tolérance, c'est Claire Etcherelli qui semble se cacher derrière
Elise - Elise, en fait, était une partie d'elle-même, au travers de son engagement.
On peut se demander si cette œuvre n'est pas le reflet de l'âme de cette femme
engagée, qui fait partie des auteurs qui écrivent en faveur de la cause algérienne.
L'image du travail sollicite le lecteur dans l'interprétation qu'il fait de
l'usine en trame de fond de ce drame socio-culturel.